Parité inversée : un tabou de plus?
Publié le 2025-03-27
Il est 8h33. Je décide d’écrire ce texte, sachant que je vais marcher sur des œufs. Pourtant, je ne devrais pas. On s’époumone dès qu’on entend parler d’un pays qui bafoue la liberté d’expression, et pourtant, on se censure nous-mêmes dans nos tabous et dans nos écrits. N’oublie pas que les écrits restent, me disait une gestionnaire du réseau… Ouache…
Deuxième introduction. Ce texte ne se veut ni masculiniste ni antiféministe. Veuillez continuer de lire seulement si vous acceptez les conditions mentionnées précédemment… Maintenant que chaque site internet possède son propre contrat d’entrée, pourquoi ne pas faire de même avec les textes?
Mise en contexte. Je suis dans le réseau de la santé depuis 2012. Je discute avec un collègue avec qui je suis allé au CÉGEP il y a 20 ans… Ouache… 20 ans… Bref, ce dernier est resté dans le domaine des communications, alors que moi, non. On jase, en début de rencontre, de ce qu’on est devenus et de ce que d’autres sont devenus.
On en vient à discuter du réseau de la santé. Voilà qu’il me parle d’une perception qu’il a eue lors d’une expérience avec le réseau. Il a trouvé que l’approche n’était parfois pas au goût du jour. Soyons francs, nous avons surtout parlé d’un réseau de « matantes ». Si vous lisez ce texte et que vous n’êtes pas québécois : oui, l’expression provient de la contraction de « ma tante ». Je n’irai pas chercher de définition dans le dictionnaire, mais ce qualificatif est, pour moi, synonyme de vieillot, dépassé, et teinté d’une attitude paternaliste.
Oui, c’est ironique. Des tantes paternalistes. Au moins, ça sonne 2025…
Bref, mon point est le suivant : la parité est positive dans les deux sens. Oui, la place des femmes a été – et est encore – bafouée par des inégalités dans notre société. Or, ce n’est pas une raison pour commettre la même erreur avec les hommes. Après dix années à étudier et à faire partie de différentes équipes, j’ai souvent fait le même constat, étant fréquemment le seul homme parmi le personnel.
Il existe une différence d’approche fondamentale entre les hommes et les femmes, et la présence des deux sexes apporte, à mon avis, une vision beaucoup plus holistique, compte tenu justement de ces différences d’approche, auxquelles s’ajoutent les traits personnels propres à chacun.
À cet effet, une étude de Woo, Goh et Zhou (2022) démontre la perte d’intérêt des hommes à progresser dans la profession, ce qui explique le faible nombre d’infirmiers en pratique avancée.
J’ai d’ailleurs été étonné de discuter avec des collègues étudiants qui valorisaient le fait que la profession infirmière soit à prédominance féminine. Personnellement, je trouve ce fait contre-productif. Oui, je reconnais qu’il s’agit d’une profession créée par des femmes. Oui, je reconnais la place des femmes dans cette profession et dans son évolution. Oui, les femmes ont certaines aptitudes de caring innées que les hommes n’ont pas.
Toutefois, caring ne se traduit pas par l’expression québécoise « maternage », qui témoigne d’une attitude maternante et infantilisante, tel que m’expliquait le collègue avec qui j’ai eu cette discussion. Et ici, je le cite en exemple, mais il est loin d’être le seul : il est venu valider une perception que je vivais moi-même à titre de clinicien.
Oui, il serait possible de corréler l’étude citée avec plein d’autres études qui démontrent, par exemple, qu’il est encore difficile pour des femmes d’obtenir des postes d’autorité, même en santé, tel que mentionné dans l’article de Gauci et al. (2023). Mais mon point, dans cet article, n’est pas là. Mon argument est centré sur le patient.
Une équipe interdisciplinaire avec une parité de genre serait, à mon avis, bénéfique pour le patient durant la prestation de soins. Est-ce réaliste? Peu importe. La seule chose que l’on peut faire, c’est mettre des efforts pour attirer plus d’hommes dans la profession et valoriser l’expertise en soins infirmiers.
En passant, il est 9h26.
Et voilà, c’étaient mes deux cents pour aujourd’hui.
Références
- Gauci, P., Luck, L., O’Reilly, K., & Peters, K. (2023). Workplace gender discrimination in the nursing workforce—An integrative review. Journal of Clinical Nursing, 32, 5693–5711. https://doi.org/10.1111/jocn.16684
- Woo, B. F. Y., Goh, Y. S., & Zhou, W. (2022). Understanding the gender gap in advanced practice nursing: A qualitative study. Journal of Nursing Management, 30(8), 4480–4490. https://doi.org/10.1111/jonm.13886
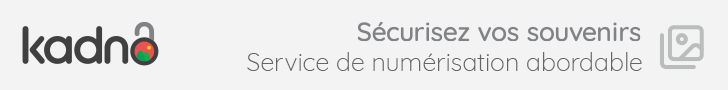
Commentaires
Les commentaires se doivent de respecter le principe de la nétiquette, soit être rédigé de manière lisible et que le contenu soit poli et respectueux. Dans le cas contraire, le commentaire ne sera pas publié et sera supprimé. Toutes infractions à la loi québécoise seront rapportées aux autorités concernées.